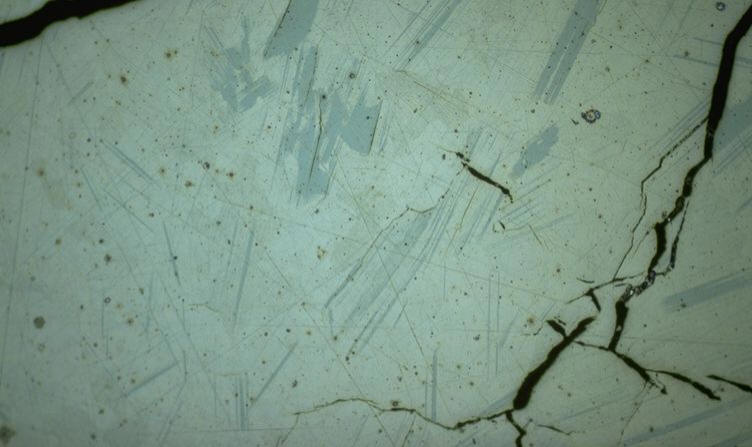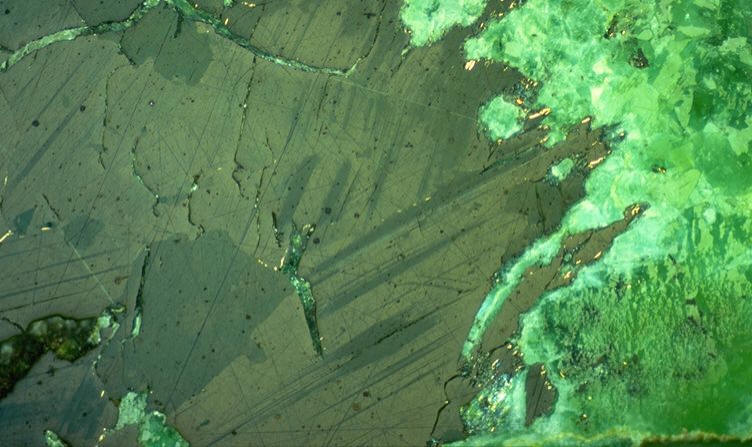Minéral typique des filons hydrothermaux et des zones
d'oxydation des gisements de cuivre. En cristaux prismatiques tabulaires,
pseudo-hexagonaux. Macle pseudo-hexagonale tabulaire commune, parfois en forme
de croix. Généralement en masses finement grenues à compactes, en inclusions ou
en enduits. En pseudomorphoses de bois fossiles, en incrustations sur des
racines. Opaque. Éclat métallique. Couleur noir-gris de plomb, gris à noir par
altération à l’air. Poussière gris sombre. Les beaux échantillons proviennent de
Redruth (Cornouailles, Grande-Bretagne) et de Bristol (Connecticut).
|
Année de découverte : |
1832 |
|
Étymologie : |
Minéral décrit par James Dwight Dana en 1868 et
nommé d’après la racine grecque χαλκóσ (chalkos) désignant le cuivre |
|
Localité type : |
|
|
Synonyme : |
|
|
Couleur : |
Gris noirâtre, noir, gris acier |
|
Éclat : |
Métallique |
|
Transparence : |
Opaque |
|
Morphologie : |
Pseudo-hexagonale, prismatique, tabulaire, massive, bipyramidale,
agrégat, grenue, terreuse, enduit, compacte, pulvérulente, étoilée,
macle. |
|
Solubilité : |
Dans l'acide nitrique en donnant une solution verte |
|
Trait : |
Gris noirâtre, noir gris |
|
Autres propriétés : |
Fragile / cassante / malléable / striée / sectile |
|
Minéraux associés : |
la plupart des minéraux de cuivre et des sulfures
courants |
|
Liste des minéraux associés : |
Bornite Chalcopyrite Covellite Cuivre Cuprite
Galène Pyrite Sphalérite |
|
Forme : |
cristaux prismatiques courts ou tabulaires
pseudo-hexagonaux, également en masses compactes |
|
Clivages : |
très peu marqués (110) |
|
Cassure : |
conchoïdale |
|
Classe : |
Sulfures |
|
Classe cristalline : |
2/m |
|
Fréquence : |
rare comme minéral primaire mais très fréquent
comme minéral secondaire |
|
Utilisation : |
le principal minerai de cuivre à l'heure actuelle |
|
Gisements : |
zone de cémentation de tous les gisements
cuprifères |
|
Dureté: |
2.70 |
|
Densité mesurée : |
5.70 |
|
Système cristallin : |
Monoclinique |
|
a : |
15.246 Å |
|
b : |
11.884 Å |
|
c : |
13.494 Å |
|
alpha : |
90° |
|
beta : |
116.35° |
|
gamma : |
90° |
|
Z : |
48 |
|
Diagramme X : |
|
d(Å) |
1.278 |
1.695 |
1.870 |
1.969 |
2.4 |
3.05 |
3.21 |
3.390 |
|
Intensité |
3 |
4 |
10 |
8 |
7 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Couleur naturelle |
: |
Blanche ou blanc-gris avec une
nuance bleutée qui apparaît bien au contact de la galène. Au contact de
la digenite, elle est blanche |
|
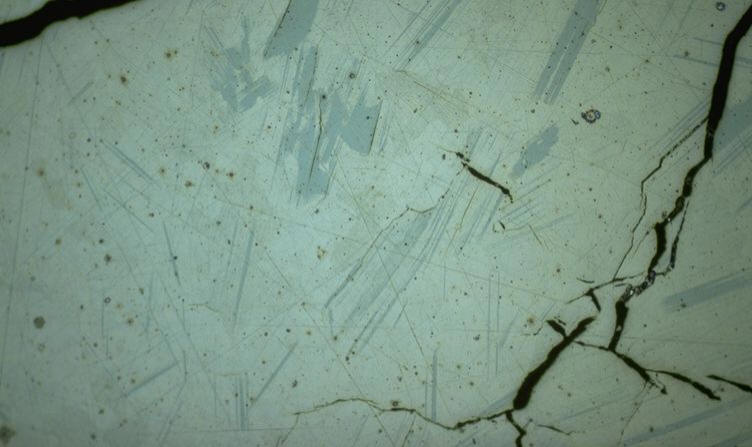 |
|
Chalcocite (blanche) et
digénite (bleutée) (Niari , Congo), - 1,6 mm - |
|
collection BRGM, cliché E. Marcoux |
|
|
Pléochroisme |
: |
Inexistant |
|
Couleur de Pléochroisme |
: |
? |
|
Poli |
: |
Bon mais les rayures sont
difficiles à éviter |
|
Pouvoir Réflecteur |
: |
Moyen. Analogue à celui des cuivres
gris. A peine supérieur à celui de la digénite |
|
Diagramme du Pouvoir Réflecteur |
: |
|
Lambda |
420 |
440 |
460 |
480 |
500 |
520 |
540 |
560 |
580 |
600 |
620 |
640 |
660 |
680 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensité 1 |
36.70 |
36 |
35.20 |
34.4 |
33.5 |
32.60 |
31.80 |
31 |
30.2 |
29.60 |
29 |
28.4 |
28 |
27.5 |
27.10 |
|
Intensité 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|